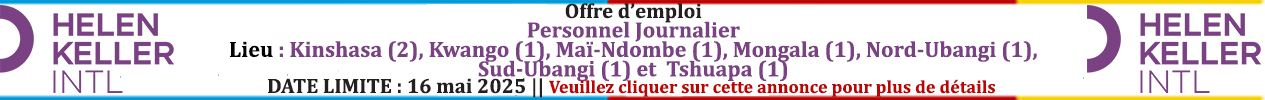Entretien. Kinshasa n’a pas changé d’un iota sa position, tranche Thierry Monsenwepo, l’un des cadres de l’Union sacrée. Elle demeure constante : pas de négociation avec des pantins, mais un dialogue avec des Congolais détachés de toute influence étrangère.
Voix audible de la majorité au pouvoir, Monsenepwo rappelle dans un entretien à Ouragan que les faits donnent aujourd’hui raison à Félix Tshisekedi, qui a toujours prôné une approche équilibrée : « le bâton pour Kagame, la carotte pour les Congolais égarés ».
D’ailleurs, confie-t-il, la délégation congolaise va le 18 mars négocier à Luanda en position de force. Les preuves sont là, se flatte le communicateur de l’Union sacrée qui égrène les hauts faits de la diplomatie congolaise : « Paul Kagame est désormais isolé diplomatiquement et sous sanctions et surtout la communauté internationale reconnaît l’agression rwandaise ». A ses yeux, le rapport de force s’est inversé, assurant que « c’est sous cette nouvelle dynamique que les discussions s’engagent ».
Pourquoi avoir attendu si longtemps pour enfin accepter de négocier avec le M23 ?
La position de la RDC a toujours été constante : pas de négociation avec des pantins manipulés par une puissance étrangère. Dès le début de son mandat, le président Félix Tshisekedi a privilégié les solutions pacifiques en activant le processus de Nairobi pour offrir une issue aux groupes armés nationaux. Le M23 a, de son propre chef, choisi de se soustraire à ce cadre en s’alignant sur les intérêts du Rwanda. Il ne pouvait donc pas être question de discuter avec une organisation servant d’instrument à Kigali.
Aujourd’hui, la communauté internationale, y compris l’Angola, l’Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies, reconnaît la pertinence de cette approche et réactive les processus de Nairobi et de Luanda. La RDC ne change donc pas de position : elle accepte de dialoguer avec un M23 détaché de son influence rwandaise, et non avec une simple émanation du régime de Kagame.
Peut-on dire que la ligne rouge est franchie ?
Non, la ligne rouge fixée par Kinshasa a toujours été claire : aucune négociation sous la menace des armes et aucune concession territoriale. Ce cadre est maintenu. Le dialogue engagé ne signifie pas un abandon des principes de souveraineté nationale, mais une volonté de pacifier l’Est dans une approche qui a toujours été celle du chef de l’État.
Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui puisque le Rwanda reste toujours l’agresseur ?
Ce qui a changé, c’est que le monde entier reconnaît désormais l’agression rwandaise. Pour la première fois en 29 ans, Paul Kagame est sanctionné à un niveau jamais atteint, notamment par les États-Unis et l’Union européenne. Cette prise de conscience internationale renforce la position de la RDC et donne plus de crédibilité aux négociations, puisque le Rwanda est désormais sous pression.
Et le M23 avec qui le gouvernement va négocier, garde-t-il toujours son statut de mouvement terroriste ?
Le M23 a été classé comme mouvement terroriste par le gouvernement congolais en raison de ses exactions contre la population. Ce statut ne peut-être levé tant que le mouvement ne renonce pas définitivement à la violence et à toute ingérence étrangère. La RDC n’accepte de dialoguer que dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda, c’est-à-dire sous des conditions strictes de désarmement et de réintégration.
Comment allez-vous négocier avec des pantins ? N’est-ce pas donner raison à Kigali qui a toujours défendu la thèse d’un problème entre Congolais ?
C’est justement parce que le M23 a été un pantin de Kigali que la RDC a refusé de négocier avec lui jusqu’à présent. L’enjeu est de s’assurer que ces discussions se fassent sans l’ombre du Rwanda. Si le M23 revient dans un cadre congolais, sans influence extérieure, cela signifie qu’il accepte enfin d’abandonner son rôle d’instrument de l’agression rwandaise.
Fallait-il attendre la presse angolaise pour passer aux aveux et prendre acte du dialogue ?
Il ne s’agit pas d’aveux, mais d’une confirmation d’une approche constante. La RDC n’a jamais exclu le dialogue dans le cadre des mécanismes africains qu’elle-même a initiés. L’Angola, en tant que médiateur, joue son rôle en réactivant une dynamique que Kinshasa a toujours prônée.
A présent, n’estimez-vous pas que la RDC ira à la table des négociations en position de faiblesse ?
Au contraire, la RDC y va en position de force parce que :
– Paul Kagame est désormais isolé diplomatiquement et sous sanctions ;
- Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont renforcé leur posture défensive ;
- La communauté internationale reconnaît enfin l’agression rwandaise.Le rapport de force s’est inversé, et c’est sous cette nouvelle dynamique que les discussions s’engagent.
Avons-nous gagné ou perdu en négociant avec le M23 ?
La RDC ne négocie pas avec le M23 dans sa version instrumentalisée par le Rwanda, mais avec un M23 contraint de revenir dans le cadre des mécanismes initiés par Kinshasa. Ce n’est donc pas une défaite, mais une victoire diplomatique, car le Rwanda est mis hors-jeu.
D’aucuns redoutent que la politique conciliante de Luanda vis-à-vis de l’administration Tshisekedi ne contraigne la RDC à abandonner ses revendications sur un pan de son plateau continental congolais occupé par l’Angola qui y pompe du pétrole. Comment évolue ce dossier ?
Le dossier du plateau continental est indépendant des négociations sur le M23. La RDC défend fermement ses droits devant les instances compétentes. L’Angola est un partenaire stratégique dans plusieurs domaines, mais cela n’exclut pas que la RDC poursuive ses revendications légitimes sur ses ressources.
Le plus grand handicap pour la RDC, n’est-ce pas de manquer un allié fort à l’international ?
La RDC a aujourd’hui plusieurs partenaires stratégiques :
– Les États-Unis (qui sanctionnent enfin le Rwanda) ;
- L’Union européenne ;
- La Russie, qui manifeste un intérêt croissant ;
- La Chine, déjà présente économiquement.
Plutôt qu’un seul allié, la RDC adopte une diplomatie pragmatique et multilatérale pour défendre ses intérêts.
La Russie est intéressée par le potentiel gazier et pétrolier de la RDC, mais l’administration Tshisekedi ne mise que sur les États-Unis. Quelle est votre lecture ?
L’administration Tshisekedi adopte une approche équilibrée. Si les États-Unis sont un partenaire stratégique, la RDC ne ferme pas la porte à la Russie ni à d’autres puissances. L’objectif est d’exploiter nos ressources avec des partenaires sérieux, tout en évitant toute dépendance exclusive.
Que gagne la RDC à demeurer membre des organisations régionales (EAC, CEEAC, SADC) qui l’abandonnent en cas de crise sécuritaire ?
L’intégration régionale reste une nécessité économique et stratégique. Cependant, la RDC a exprimé son mécontentement vis-à-vis du manque de solidarité de certains partenaires, notamment au sein de l’EAC. L’option d’un retrait de certaines organisations est sur la table, mais toute décision sera prise en fonction des intérêts du pays.
Napoléon Bonaparte disait : “Les seuls traités qui comptent sont ceux qui lient les arrière-pensées”. Quel crédit accorder à des négociations avec des rebelles manipulés par le Rwanda ?
Cette citation s’applique parfaitement à la situation actuelle. Toute négociation ne vaut que si elle repose sur des garanties solides. C’est pourquoi Kinshasa insiste sur un cadre strictement congolais et africain, sans interférence étrangère. Le but est de neutraliser l’agenda expansionniste du Rwanda et de rendre toute manipulation impossible.
…Conclusion…
La RDC ne change pas de position : pas de négociation avec des pantins, mais un dialogue avec des Congolais détachés de toute influence étrangère. Aujourd’hui, les faits donnent raison à Félix Tshisekedi, qui a toujours prôné une approche équilibrée : le bâton pour Kagame, la carotte pour les Congolais égarés.
Propos recueillis par Grady Mugisho et Pold Levi
OURAGAN