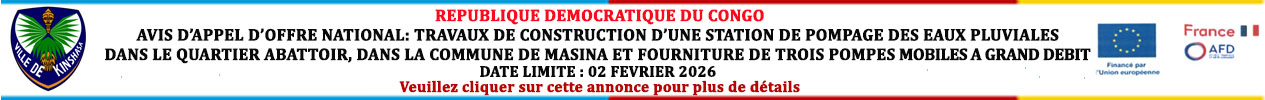Le Bangladesh s’est réveillé ce vendredi 9 août avec un nouveau gouvernement. À sa tête, Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix et banquier des pauvres, a effectué un retour triomphal dans son pays.
L’ambiance est calme, comme tous les vendredis, jour chômé au Bangladesh. Les quelques personnes croisées dans la rue expriment leur désir de changement mais aussi leur confiance dans ce que certains appellent « une révolution » et d’autres « une deuxième indépendance ».
« Ce que les étudiants et les gens dans leur ensemble ont accompli est le reflet de nos attentes. On voulait ce soulèvement massif. Le gouvernement de l’époque a essayé de présenter son peuple et l’opposition de manière général comme des extrémistes ou des terroristes. Mais le Bangladesh ce n’est pas ça. Ce qui se passe aujourd’hui reflète le ressentiment de la population par rapport à tout ce qu’elle a vécu ces quinze dernières années », explique Lalchand Badsha, 29 ans.
Une tâche lourde attend l’autorité de transition
Les personnes rencontrées souhaitent désormais que l’on se concentre sur les besoins de la population. Ils sont nombreux à avoir besoin de sécurité. Les forces de l’ordre ont déserté les rues et plus de 230 personnes sont mortes depuis la chute du régime lundi.
Un besoin de justice également se fait sentir pour les victimes des manifestations. Des rassemblements en leur mémoire sont prévus ce vendredi. Justice également pour les autres victimes du régime et les nombreux prisonniers politiques notamment.
Une tâche très lourde attend donc l’autorité de transition qui devra à la fois panser les plaies d’un pays meurtri par la violence mais surtout restaurer une démocratie très abimée par quinze années de gouvernance autocratique.
Face à l’absence de police, les habitants s’organisent autrement
Ciblés par certains pour leurs agissements, les policiers n’effectuent plus leurs missions, comme gérer le trafic. Alors manifestants, associations et citoyens s’organisent autrement.
Trouver un feu rouge qui n’a pas été détruit durant les manifestations est devenue une mission presque impossible et cela a nettement aggravé une circulation déjà chaotique. « Il n’y a pas de loi pour l’instant contre les voitures ou les autres véhicules s’ils ne respectent pas les règles de sécurité. C’est un problème car les gens n’ont pas conscience du danger et ne sont pas vigilants », explique Fahim, volontaire au Croissant-Rouge dans un carrefour agité de la capitale.

Lima Akter Mim, 22 ans, étudiante, porte un gilet jaune et un sifflet à la bouche depuis lundi : « Là, dans ce camp, on m’a donné cette veste. Il n’y a plus de police qui s’occupe de la circulation. C’est pour cela que nous, les étudiants, nous remplaçons la signalisation. Tout le monde nous respecte et apprécie ce que l’on fait. »
À ses côtés, Fahan aussi se réjouit de la réaction des chauffeurs. « Les gens nous soutiennent avec de l’eau, de la nourriture et nous aident avec tout. On n’a aucun souci ou problème ! », dit-il. Finhaz a, lui, tenu à apporter des parapluies aux policiers de fortune. « Les étudiants accomplissent leurs missions sous le soleil. On s’est dit que c’était la meilleure chose à leur donner », pense-t-il. Tous assurent vouloir faire leur part pour la construction de ce qu’ils appellent « un nouveau Bangladesh ».
Avant Muhammad Yunus, plusieurs dissidents Nobel de la paix ont dirigé leur pays
Après les violences qui ont fait plus de 455 morts au Bangladesh, la place est à l’euphorie et à l’espoir. Ces derniers sont incarnés par l’économiste Muhammad Yunus, choisi par les leaders étudiants pour prendre les rênes du gouvernement provisoire. Celui qui est surnommé « le banquier des pauvres a obtenu le prix Nobel de la paix en 2006 pour avoir sorti des millions de personnes de la pauvreté grâce à sa méthode de micro-crédits proposés par sa banque, la Grameen Bank, pionnière en la matière.
Muhammad Yunus n’est pas le seul dissident au monde à accéder au pouvoir. Ces 35 dernières années, cinq personnalités ont été récompensées pour leur engagement pacifiste et humaniste avant de se hisser au pouvoir. Parmi elles, il y a trois Asiatiques. À commencer par Aung San Suu Kyi, l’opposante historique à la junte birmane, nobélisée en 1991, en résidence surveillée pendant des années, est finalement parvenue à la tête du pays avant un retour à la case prison suite au putsch de 2021.
Une autre figure incontournable est celle de José Manuel Ramos Horta, l’infatigable porte-parole de la résistance du Timor oriental à l’oppression du régime indonésien. Prix Nobel en 1996, Ramos Horta devient le chef de l’État insulaire en 2007.
Le Sud-Coréen Kim Dae-jung, condamné à mort, rescapé d’une tentative d’assassinat, a lui d’abord élu président en 1998 avant de recevoir le prix Nobel pour sa main tendue à la Corée du Nord. Sans oublier Nelson Mandela, le héros anti-apartheid sud-africain, qui après 27 ans de prison a été nobélisé en 1993 et est devenu l’année d’après le premier président noir élu démocratiquement.
En Europe enfin, le premier président de la Pologne post-communiste en 1990, Lech Walesa, avait été nobélisé dès 1983, en pleine lutte à la tête de son syndicat Solidarité.
RFI via CONGO PUB Online