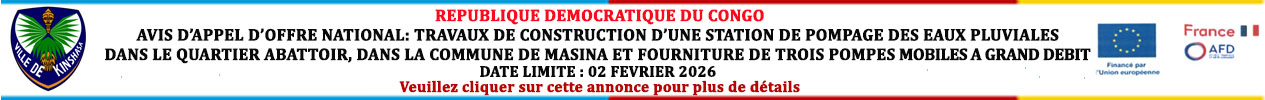L’appui massif de la Banque mondiale au secteur gazier du Ghana devait soutenir le développement économique du pays. Il a surtout engendré une dette importante du secteur énergétique, des tarifs d’électricité en forte hausse, et une dépendance prolongée aux énergies fossiles.
En 2007, le Ghana découvre d’importants gisements de pétrole et de gaz en mer. Présentée comme une opportunité historique, cette manne attire l’appui de la Banque mondiale, qui a injecté près de 2 milliards de dollars dans le secteur depuis lors. L’un des projets phares est le champ gazier Sankofa, auquel la Banque apporte 1,2 milliard de dollars en financements et garanties dès 2015. Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large de la Banque visant à restructurer le secteur énergétique du Ghana en s’appuyant sur des partenariats public-privé (PPP) et une ouverture accrue au capital privé.
Une transformation qui s’accompagne de contrats types incluant des clauses dites « take or pay » qui impliquent que le Ghana s’engage à payer un volume fixe de gaz, qu’il le consomme ou non. Et comme la demande d’électricité fluctue, et que certaines infrastructures de transport ou de transformation ne sont pas toujours opérationnelles, une partie du gaz livré n’est pas utilisée.
D’ailleurs, en 2021, une étude de la Chambre ghanéenne des distributeurs de produits pétroliers en vrac (CBOD) a montré que le pays accumule autour de 500 millions de dollars de dettes chaque année, à cause de ce deal.
Un mécanisme qui pousse à produire plus pour ne pas perdre encore plus
Pour éviter de perdre ce gaz payé d’avance, le pays est donc fortement incité à produire de l’électricité même quand ce n’est pas nécessaire ou optimal. Cela crée une surcapacité et pousse à faire tourner des centrales thermiques, souvent exploitées par des producteurs d’électricité indépendants (IPP), eux aussi sous contrat avec des clauses avantageuses, ce qui renchérit significativement le prix de l’électricité produite. Par conséquent, le Ghana subventionne massivement le secteur pour couvrir les pertes, et la population paie l’électricité plus cher, sans gain notable en fiabilité ou en accès universel.
L’obligation de payer à la fois le gaz non utilisé et l’électricité produite à des prix contractuellement fixés a plongé le pays dans une spirale d’endettement énergétique. La dette du secteur énergétique a affiché plus de 3 milliards de dollars fin 2024.
La Banque mondiale a promu un modèle standardisé centré sur l’investissement privé et l’exploitation rapide des ressources fossiles, sans prendre suffisamment en compte la capacité du pays à absorber ce type de contrats complexes. En cherchant à rendre le secteur plus attractif pour les investisseurs étrangers, elle a fait porter à l’Etat ghanéen l’essentiel des risques liés à ces projets, constate un rapport d’ActionAid Ghana et l’organisation de la société civile néerlandaise SOMO. Intitulé « Gaslighting Ghana : How World Bank-backed projects drive crippling energy debt and fossil fuel dependency in Ghana », le document poursuit qu’au lieu de construire un système énergétique public, stable et progressif, les réformes ont introduit des engagements financiers rigides, en décalage avec la réalité de la demande domestique, de la planification nationale et des infrastructures disponibles.
Ce fiasco arrive dans un contexte où la Banque mondiale envisage de revenir sur sa décision de 2017 d’arrêter de financer les projets gaziers en amont. Le cas ghanéen devrait servir d’avertissement. Pour les rédacteurs du rapport, il est impératif de mettre fin aux nouveaux projets fossiles, annuler la dette liée aux hydrocarbures et réorienter les financements internationaux vers des systèmes publics, renouvelables et résilients. Cela implique également de repenser le rôle des institutions financières internationales dans la transition énergétique du continent.
Olivier de Souza
Agence Ecofin