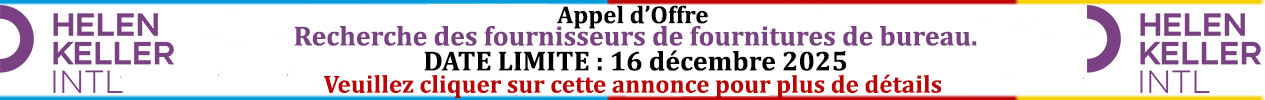Alors que les États-Unis viennent de sanctionner l’Alliance Fleuve Congo (AFC) et ses alliés, dont le M23, une question persiste : pourquoi ce groupe, accusé de crimes graves, bénéficie-t-il d’une place à la table des négociations à Doha, tandis que le FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda) reste systématiquement exclu, bien que les deux mouvements soient responsables d’exactions similaires ?
Cette différence de traitement soulève des interrogations sur la cohérence de la politique de paix en République démocratique du Congo (RDC) et met en lumière les calculs géopolitiques qui influencent les processus de résolution des conflits.
Le M23 à Doha : Une légitimation controversée
Le M23, mouvement rebelle soutenu par le Rwanda selon les rapports des experts de l’ONU, est pourtant un groupe sous sanctions internationales pour crimes de guerre, dont les massacres de Kishishe et les déplacements forcés de centaines de milliers de civils.
Pourtant, depuis mai, ses représentants participent aux pourparlers de paix organisés à Doha, sous médiation qatarie et africaine. Une présence qui interroge, alors même que le mouvement continue ses activités militaires dans le Nord-Kivu.
Pourquoi cette tolérance ?
- Le poids du Rwanda : Kigali, soutien présumé du M23, reste un acteur clé dans la région, ce qui pousse les médiateurs à inclure le groupe dans les discussions.
- Une stratégie de Kinshasa : Certains analystes estiment que le gouvernement congolais utilise ces négociations pour gagner du temps sur le terrain militaire.
- La fatigue diplomatique : Face à un conflit qui dure depuis des décennies, la communauté internationale privilégie une solution négociée, même avec des acteurs controversés.
Le FDLR, l’éternel exclu des négociations
À l’inverse, le FDLR, mouvement rwandais hutu présent en RDC depuis 1994, reste systématiquement exclu des processus de paix. Officiellement considéré comme une « organisation génocidaire » en raison de ses liens historiques avec le génocide rwandais, le groupe est aujourd’hui militairement affaibli, avec moins de 1 500 combattants estimés en 2025.
Pourtant, ses exactions récentes (recrutement d’enfants, attaques contre des civils) sont comparables à celles du M23.
Pourquoi ce traitement différencié ?
- L’instrumentalisation par Kigali : Le Rwanda utilise la menace du FDLR pour justifier ses interventions en RDC.
- La narrative politique : Kinshasa en fait un bouc émissaire pour mobiliser l’opinion publique et les partenaires internationaux contre « les génocidaires ».
- Le silence des Occidentaux : Les États-Unis et l’UE évitent de remettre en cause le Rwanda, partenaire stratégique dans la région.
Une paix impossible sans cohérence
Cette approche à deux vitesses pose un problème majeur : elle légitime l’impunité pour certains groupes armés tout en diabolisant d’autres, alimentant ainsi le cycle de violence.
Les risques :
- Radicalisation des exclus : Le FDLR, marginalisé, pourrait se durcir.
- Perte de crédibilité des médiateurs : L’ONU et l’Union africaine apparaissent incohérentes.
- Déstabilisation durable : Sans justice équitable, aucun accord ne tiendra sur le long terme.
Que faire ? Vers une solution équitable
Pour une paix durable, plusieurs pistes doivent être explorées :
1️⃣ Conditionner les négociations avec le M23 à un désarmement vérifiable.
2️⃣ Réévaluer le statut du FDLR en distinguant ses éléments historiques de ses combattants actuels.
3️⃣ Sanctionner tous les groupes armés sans exception, y compris les Maï-Maï et CODECO.
4️⃣ Pression accrue sur le Rwanda pour qu’il cesse son soutien au M23.
Conclusion
La paix en RDC ne pourra être durable que si elle s’applique de manière juste et cohérente. Soit tous les groupes armés sont exclus des négociations, soit ils y sont tous inclus sous les mêmes conditions.
Dans le cas contraire, le pays restera englué dans un conflit sans fin, où les criminels seront tantôt partenaires, tantôt ennemis, selon les intérêts du moment.
Par Basengezi Ntomo, correspondant à Goma
CONGO PUB Online